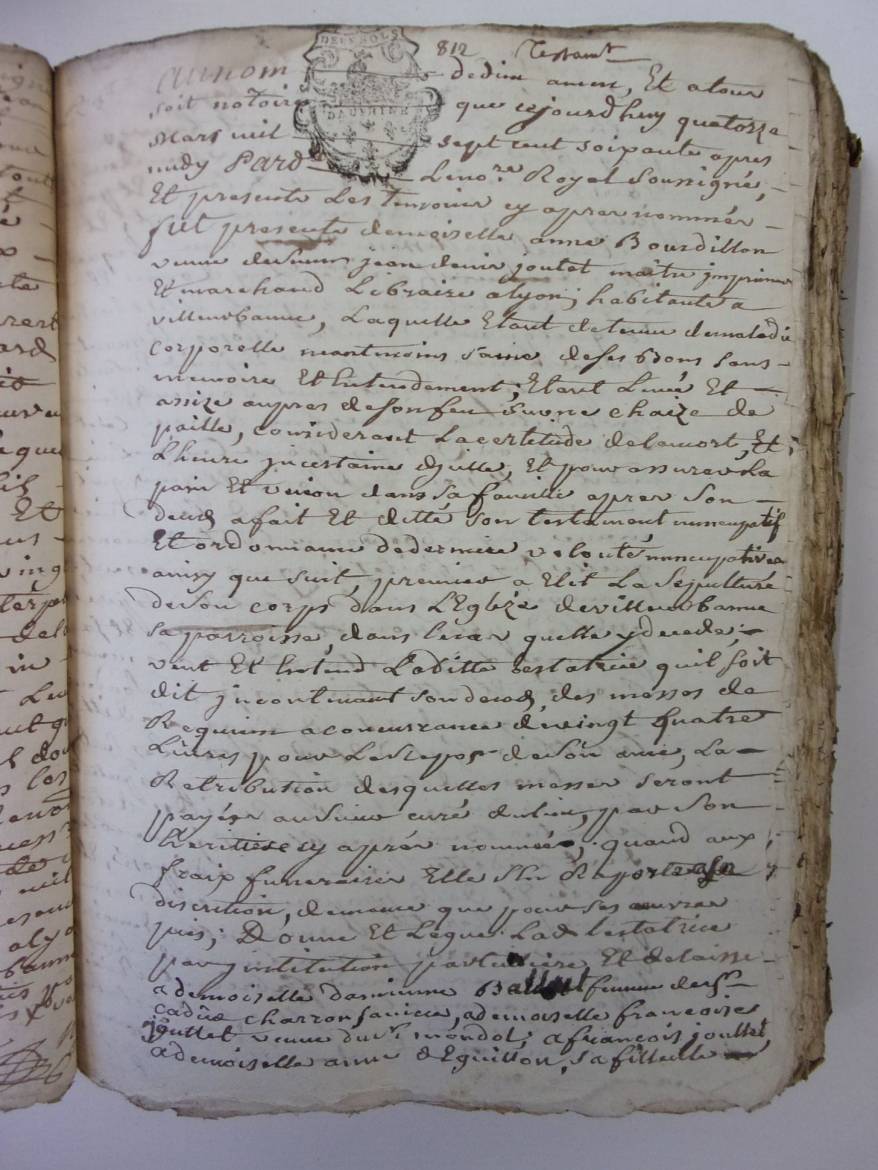L'HISTOIRE - Les réfugiés de la Grande Guerre
1 novembre 2016

Gabrielle Morlet est partie aussi vite que possible. Dès le déclenchement de la guerre, en août 1914, elle a quitté son village des Ardennes en compagnie de ses deux sœurs de 13 et 14 ans, et a pris la route en direction du sud, fuyant l’invasion des troupes allemandes. Les nouvelles d’exécutions sommaires, d’incendies de villages et de pillages, ont suffi à provoquer l’exode massif des civils. Gabrielle a erré sans but et pratiquement sans bagages, ne comptant que sur l’expérience de ses 21 ans pour trouver son salut. Comme tous les hommes en âge de se battre, son mari était mobilisé sur le front, ou peut-être prisonnier des Allemands. Après des semaines de périple à pied et en train, Gabrielle Morlet arrive en septembre 1914 à Villeurbanne, dans une maison de la rue Frappaz, que son propriétaire a ouverte à une dizaine de réfugiés. À cette date, alors que la guerre n’a commencé qu’un mois auparavant, notre ville accueille déjà 51 exilés. Et ce n’est qu’un début. Au nord et à l’est de la France, les Allemands envahissent une dizaine de départements, et soumettent au feu de leurs canons les villes de Reims, de Verdun, et du nord du bassin parisien. De son côté, l’État-major décide d’évacuer préventivement les habitants des places fortes et des communes situées près du front. En quatre ans de guerre, plus de 2 millions de Français et aussi des centaines de milliers de Belges, pour la plupart des femmes accompagnées de leurs enfants ou des personnes âgées, se retrouvent ainsi jetés sur les routes.
L'exode des civiles pendant la guerre. ©Carte postales collection A. Belmont
L'exode des civiles pendant la guerre. ©Carte postales collection A. Belmont
Jour après jour, ces réfugiés arrivent en gares de Perrache et des Brotteaux, où les autorités les redirigent comme elles peuvent vers les villages du Rhône et, bien sûr, vers les villes. À Villeurbanne, leurs effectifs ne cessent de grossir : ils atteignent 476 fin 1916, et culminent à 1 700 personnes en 1918 – un chiffre à mettre au regard des 42 000 Villeurbannais comptabilisés par le recensement de 1911. Jamais la ville n’a connu dans son histoire un tel afflux de victimes de guerre. Aisne, Seine-et-Marne, Meurthe-et-Moselle, Belgique, Pas-de-Calais, Nord, Vosges, Meuse, Marne, Somme, Ardennes, Alsace : la provenance de ces pauvres gens dessine la géographie du conflit. À leur arrivée, ils se retrouvent complètement démunis : « Nous sommes partis de la Somme le 26 mars [1918] et avons eu juste deux minutes et j’ai sept enfants ; nous avons laissé notre maison et là, nous n’avons plus rien de chez nous, plus de meubles, plus de linge, c’est bien triste », témoigne Madame Pringuet. Rapatriée de Caudry, près de Cambrai, Maria Bricout raconte de son côté qu’elle est restée « deux ans et demi dans les pays envahis ; je vous assure que l’on a bien souffert, et arrivé ici en France, il nous manque de tout ». Devant le flot de réfugiés, les autorités peinent à faire face. Les allocations mensuelles prévues par la loi, les secours apportés par les associations caritatives, et les soupes populaires distribuées par la municipalité, ne suffisent pas à affronter le quotidien. Aussi les populations déplacées doivent-elles surtout compter sur elles-mêmes. Lorsqu’ils réussissent à trouver un emploi, les réfugiés parviennent à payer les 40 à 50 francs de loyer de leur petit logement, et à vivre bon an mal an – comme le Belge Jean-Pierre Janssens, forgeron dans une usine, tandis que ses deux fils de 15 et 19 ans travaillent comme ouvriers agricoles. Par contre, pour les simples mères au foyer, chargées d’enfants en bas âge et hors d’état de travailler, l’allocation versée par l’État s’avère insuffisante à payer toutes leurs charges. Elles s’entassent dans des taudis loués hors de prix, et se retrouvent sans un sou pour acheter du charbon et des vêtements chauds pour se protéger de l’hiver. La misère devient le lot quotidien de ces familles éclatées par la guerre.
Wervik, la ville d'origine de Cyrille Vercamer, réfugié à Villeurbanne. ©Carte postales collection A. Belmont
Wervik, la ville d'origine de Cyrille Vercamer, réfugié à Villeurbanne. ©Carte postales collection A. Belmont
L’Armistice du 11 novembre 1918 signe-t-il enfin le terme de leur calvaire ? Loin de là. Ceux qui ont tout perdu dans le cataclysme européen doivent encore attendre plusieurs années avant de rentrer chez eux, le temps que leur commune d’origine soit reconstruite. Ainsi, Cyrille Vercamer, originaire de Wervik en Belgique, et vivant au Tonkin avec sa femme et leurs cinq enfants, se voit refuser en juillet 1919 l’autorisation de retourner au pays : « La maison occupée avant l’évacuation de cette ville par M. Cyrille Vercamer est détruite et les terres qui en dépendent sont dévastées et incultivables […] ; en outre il n’y a en ce moment ni maisons habitables ni baraquements disponibles », certifie le bourgmestre de Wervik. Résultat, un an après la fin de la guerre, en octobre 1919, Villeurbanne abrite encore 900 réfugiés. Désormais intégrés dans leur ville d’adoption, certains d’entre eux décident de ne plus la quitter. Leurs descendants comptent probablement aujourd’hui parmi nos concitoyens.
Lettres de réfugiés
Repères :
3 août 1914 : l’Allemagne déclare la guerre à la France
août 1914 : l’Allemagne envahit la Belgique, pourtant neutre
août 1914 : près de 4 millions d’hommes sont mobilisés par la France
août-septembre 1914 : bataille de la Marne. L’armée allemande est arrêtée à 50 km de Paris
fin 1914 : les armées s’enterrent dans les tranchées, sur un front de 750 km de long
février à décembre 1916 : bataille de Verdun
juillet à novembre 1916 : bataille de la Somme
avril 1917 : les USA entrent en guerre contre l’Allemagne
mai-juin 1917 : mutineries dans l’armée française
novembre 1917 : révolution russe
septembre-octobre 1918 : offensive généralisée des Alliés en France
11 novembre 1918 : fin de la Première Guerre mondiale
Un accueil mi-figue, mi-raisin
Ville ouvrière, habituée à cohabiter avec des migrants en provenance du sud-est de la France et l’Italie, Villeurbanne fut, après Lyon, la cité la plus accueillante du département du Rhône pour les réfugiés. Les témoignages de solidarité envers eux ne manquent pas, comme celui de la famille Bouche, originaire du Nord, arrivée aux Charpennes en janvier 1918 et qui, absolument sans ressources, ne dut son salut qu’aux « secours de bons voisins ». Mais tous ne furent pas aussi bien traités. À preuve, ce refus absolu du ministère de l’Intérieur de voir la Croix-Rouge américaine construire des camps d’hébergement, sous un prétexte fallacieux : « Il importe éviter afflux injustifié rapatriés dans Rhône », ordonne un télégramme de mars 1918. Pire même, les réfugiés se heurtèrent parfois à un mépris, voire à un rejet des Rhodaniens, méfiants envers ces "Boches du nord", dont l’accent n’avait rien de commun avec celui des Lyonnais, et que l’on soupçonnait de lâcheté face à l’ennemi, quand ce n’était pas d’espionnage à son profit.
L’Histoire, par Alain Belmont
Sources : Archives du Rhône, R 1392, 1611, 1614, 1624, 1646.