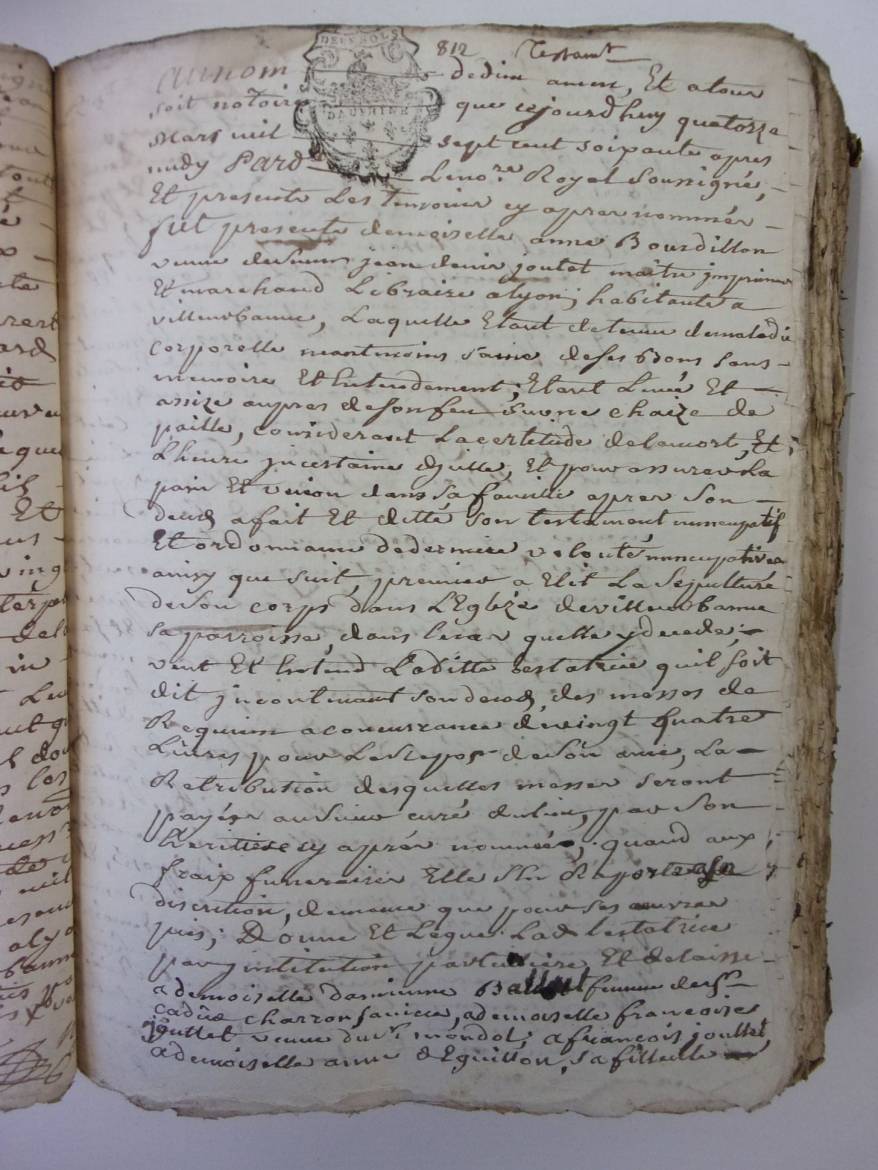L’HISTOIRE - Une passion villeurbannaise : les cabarets
28 février 2021

Un oiseau sauvage voletant dans une cage. Un chardonneret, pour être précis. C’est par ses gazouillis que les clients de Benoit Gacon, cabaretier à Villeurbanne dans les années 1780, étaient accueillis. Du moins, quand les clients en question ne faisaient pas trop de bruit ! Car il y avait foule, chez Gacon. Des Villeurbannais, mais aussi et surtout des habitants de Lyon. Depuis l’annexion du village de La Guillotière au Lyonnais par le roi Louis XIV en 1701, Villeurbanne était en effet devenue la porte d’entrée du Dauphiné, la frontière entre les deux provinces passant au ras des Maisons-Neuves et des Charpennes. D’un côté, à La Guille et à Lyon, le vin était frappé de taxes et coûtait une petite fortune, alors qu’à quelques pas de là, chez nous, on pouvait boire pour le même prix près d’un tiers d’alcool en plus. Les dimanches et les jours de fête, mais aussi chaque soir une fois leur journée de travail terminée, les Lyonnais franchissaient le Rhône et se rendaient en masse, « par forme de promenade, aux Charpennes » ou autour de la place Grandclément - la « place du Platre », comme on l’appelait à l’époque.
Les Villeurbannais comprirent vite tout le parti qu’ils pouvaient tirer de ce nouveau débouché commercial, au point que l’on vit pousser des cabarets partout : en 1773, Villeurbanne en comptait 9, puis 14 en 1789, et jusqu’à 30 en 1826, auxquels s’ajoutaient 10 cafés. Pas mal, pour une commune de seulement 4000 habitants ! Mais je vous arrête tout de suite. Derrière ce terme de cabaret, n’allez pas imaginer des lieux où l’on banquetait en regardant du french cancan ! Ces cabarets d’antan étaient des auberges rustiques, où l’on pouvait lever le coude jusqu’à plus soif, croquer un grand bout de lard, une omelette ou du saucisson, jouer aux boules, et refaire le monde avec ses amis ou le moindre inconnu. Benoit Gacon, notre amateur de chardonneret, hébergeait tous ces soiffards dans deux pièces de sa maison, où trônaient six tables immenses et une douzaine de bancs. Lui-même, mais aussi sa femme Anne Marmonier, et un domestique que l’on couchait à l’écurie, servaient dans des « chopines ou pots à la mesure de Villeurbanne », du blanc et surtout du rouge, allant depuis la piquette mêlée d’eau, jusqu’au bon « vin de Vienne », peut-être un Côte-Rôtie, en passant par le jus des vignes de Cusset. Sa cave en était pleine, avec 160 bouteilles au compteur, et surtout onze tonneaux fièrement alignés. De quoi satisfaire des clients qui avaient souvent tendance à s’attarder. Si la nuit ramenait le plus grand nombre chez eux, d’autres ne décollaient plus des tables, au point de se retrouver complètement saouls, beuglant à réveiller les morts. La commune avait beau tenter de limiter les abus, rien n’y faisait : le 28 juillet 1790, le cabaretier Claude Trux fut frappé de 20 Livres d’amende parce qu’il « donnoit à boire à cinq personnages inconnus, entre minuit et une heure dans la nuit du dimanche au lundy dernier ». Il connaissait pourtant la musique : déjà en 1737, l’un de ses prédécesseurs avait été condamné par le juge seigneurial de Villeurbanne, pour avoir « tenu son cabaret ouvert pendant toutte la nuit jusqu’au jour dhuy matin, ayant donné du vin a nombre de gens quy se sont levés querelles, ayant fait toutte la nuit un vacarme epouvantable dont toutte la parroisse a esté escandalizée ».
« Joueurs de quilles », Thomas Van Apshoven (1622-1664).
Mais il y avait plus grave. Sur les bancs de ces auberges, traînaient aussi des gens louches, voleurs à leur heure, prêts à tous les mauvais coups, que ce soit à Lyon ou dans les campagnes du Dauphiné. Tant et si bien qu’en 1791, le maire de Villeurbanne décida d’user de la manière forte. Passé dix heures du soir, les hommes de la Garde nationale entrèrent « chez tous les cabaretiers, a l’effet de les prévenir de faire sortir tous ceux qui se trouveroient a boire » ; et s’ils n’obéissaient pas, direction la prison municipale ! Peine perdue, une fois de plus. Cinq ans plus tard, en 1796, le maire en vint à réclamer l’installation d’une gendarmerie, afin de mieux surveiller « le hameau des Charpennes, lequel est considérable, et présente par la multiplicité de ses cabarets, un asile aux malfaiteurs de Lyon », et pour « arrêter les vols et les brigandages de toute espece qui s’y commettent journellement ».
En-dehors de ces débordements, les cabarets villeurbannais n’en restaient pas moins des hauts lieux de la sociabilité villageoise. Ils incarnaient aussi des espaces de liberté, où l’on critiquait volontiers le pouvoir royal, et où se préparèrent de grandes luttes sociales.
Alain Belmont, historien
Un quartier général des révoltes lyonnaises
Le 7 août 1786, éclate à Lyon la première grande révolte des canuts, même si elle ne porte pas encore ce nom. Par la « révolte des Deux Sous », les ouvriers tisseurs de soie espèrent obtenir une augmentation de salaire, et pour ce faire, se rendent maîtres de la ville en deux temps trois mouvements. Où ont-ils préparé leur coup ? Dans les cabarets des Charpennes, hors d’atteinte de la police lyonnaise. La preuve, ce poème composé à l’époque en leur honneur : « Les canuts n’ayant pas de vin, Aux Charpennes courent soudain. Là, calculant avec leurs doigts, Combien ont augmenté les droits, Et sur le vin et sur la viande, Ils se sont réunis en bandes, Pour demander avec éclat, Deux sous de plus au Consulat ». Hélas, la révolte de 1786 n’eut pas plus de succès que les célèbres révoltes des canuts de 1831 et 1834. L’armée royale reprit le contrôle de la ville, tandis que les meneurs ou supposés tels, furent pendus sur la place des Terreaux. Dont un Piémontais nommé Joseph Dapiano, qui avait eu le grand tort d’avoir été trop souvent vu dans les auberges villeurbannaises.
Ecoutez cet épisode en podcast

 cliché RMN.jpg)



.png)